Universités tunisiennes: cette autonomie dévoyée par ces « professeurs -mandarins» et groupuscules populistes

Lamari, Moktar
E4T
A s’attendait à mieux de nos universités et universitaires. Cette tête pensante a échoué l’épreuve de la transition démocratique dans le domaine de la gouvernance performance des milieux universitaire. Preuve et épreuve …
La Tunisie s’apprête à franchir un pas symbolique dans la gouvernance universitaire. Le projet de loi n°8 de 2026, déposé à l’Assemblée des représentants du peuple, vise à modifier l’article 15 de la loi n°19 de 2008 et à mettre fin à l’élection des présidents d’université, principe instauré par le décret-loi n°31 de 2011 après la révolution.
Demain, si le texte est adopté, le ministre de l’Enseignement supérieur pourra nommer les recteurs parmi les professeurs habilités, pour un mandat renouvelable. La rupture est nette : on passerait d’une légitimité élective à une légitimité administrative.
L’autonomie universitaire pervertie
Le débat est vif. La Fédération générale de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, affiliée à l’UGTT, dénonce un « recul dangereux » et un retour à la logique des nominations verticales.
Des universitaires comme Abdelkader Hamdouni, de l’Université de Monastir, rappellent que l’élection confère une légitimité scientifique et crée un équilibre entre autorité ministérielle et autonomie académique. Mounir Saidani, sociologue à Tunis El Manar, souligne qu’un président élu présente un programme débattu par ses pairs et peut être sanctionné par les urnes s’il échoue.
Ces arguments méritent d’être entendus. Mais ils ne doivent pas masquer une autre réalité, plus dérangeante : l’incapacité chronique d’une partie de la communauté universitaire à faire de l’autonomie un levier de développement du savoir, des compétences et du rayonnement international.
On a mal compris la gestion autonome
L’élection, en soi, n’a jamais garanti la qualité. Elle a parfois consacré des équilibres de clans, des compromis régionaux, des alliances idéologiques et des logiques de « copains d’abord ».
Dans de nombreuses facultés, les « collèges invisibles » gouvernent. Ils orientent les promotions, verrouillent les jurys d’habilitation, distribuent les responsabilités administratives et contrôlent l’accès aux conférences et aux subventions publiques.
Un professeur de sciences exactes confiait récemment, sous couvert d’anonymat : « Ici, ce n’est pas le meilleur article qui compte, c’est la meilleure alliance. » Un autre, en sciences humaines, ajoutait : « On a remplacé l’autoritarisme d’État par l’autoritarisme des réseaux. »
Le mal est profond lorsqu’il touche à la publication scientifique. Dans certaines disciplines, les mêmes noms se retrouvent en première position sur des articles co-signés en cascade, cités par les mêmes cercles, invités dans les mêmes colloques organisés par les mêmes équipes.
Des castes se forment autour de laboratoires puissants, dotés de budgets et de relais institutionnels. Les conflits d’intérêts sont rarement déclarés, les évaluations parfois biaisées, les pressions bien réelles. Un jeune maître-assistant résumait la situation avec amertume : « On m’a conseillé de choisir mon camp avant de choisir mon sujet de recherche. »
La sélection adverse: quand les moins productifs mènent la barque
Comment évalue-t-on un professeur universitaire ? Ce n’est ni le titre, ni l’ancienneté, ni la proximité avec un syndicat ou un parti qui devraient primer. Les critères sont connus et universels : la qualité et l’impact des publications dans des revues à comité de lecture, les indices de citation (h-index, facteur d’impact), la participation à des réseaux internationaux, la capacité à obtenir des financements compétitifs, la direction de thèses aboutissant à des carrières solides, le respect de l’éthique et des étudiants.
Un professeur se mesure à son apport au savoir et à la société, pas à sa capacité à manœuvrer dans les couloirs.
Or, le bilan global interroge. Les classements internationaux majeurs – qu’il s’agisse du Shanghai Ranking ou d’autres palmarès mondiaux – ne font guère apparaître d’universités tunisiennes parmi les institutions visibles.
Les publications sont quantitativement présentes, mais qualitativement inégales. Les diplômés peinent à s’insérer sur un marché du travail exigeant, tandis que les dépenses publiques d’enseignement supérieur continuent d’augmenter. L’équation est brutale : plus de moyens, mais peu de rayonnement.
L’UGTT a noyauté la décadence
L’UGTT, acteur central du paysage universitaire, porte aussi sa part de responsabilité. Défendre les droits sociaux est légitime. Mais la défense des statuts ne s’est pas toujours accompagnée d’une exigence équivalente en matière de productivité scientifique, d’évaluation rigoureuse et d’ouverture internationale.
Un ancien doyen le disait crûment : « On a appris à bloquer des réformes, pas à bâtir des stratégies. » La syndicalisation de la gouvernance a parfois renforcé les rapports de force internes au détriment de la performance académique.
Faut-il pour autant applaudir la recentralisation ? Rien n’est moins sûr. La nomination ministérielle pourrait corriger certains abus locaux, mais elle risque d’introduire d’autres dépendances, d’autres loyautés, d’autres formes d’alignement. Un président nommé regardera-t-il d’abord vers sa communauté académique ou vers l’autorité qui l’a désigné ? La question de la légitimité demeure.
Le véritable enjeu n’est peut-être pas l’élection contre la nomination, mais la culture d’évaluation et de responsabilité, contre les diktats des clans et collèges invisibles. On peut élire des médiocres comme on peut nommer des excellents.
Ce qui manque, c’est un système transparent d’indicateurs publics : tableaux de bord par université, taux d’insertion des diplômés, volume de publications indexées, nombre de partenariats internationaux, respect des délais de thèse, évaluation anonyme des enseignements par les étudiants. La lumière est le meilleur antidote aux clans.
La Tunisie ne peut se permettre d’être trahie par ses propres élites académiques. L’université n’est pas un champ de bataille idéologique ni un terrain de distribution de privilèges.
Elle est un espace de production de savoir, de formation de compétences utiles et employables, et de rayonnement culturel et scientifique. Si les universitaires veulent préserver leur autonomie, ils doivent prouver qu’ils savent l’exercer avec rigueur, équité et ambition.
Au fond, la loi sur la nomination des recteurs agit comme un révélateur. Elle met à nu les fragilités d’un système qui n’a pas su transformer la liberté retrouvée en excellence partagée. Un système de sélection adverse s’est installé, le principe des « amis d’abord » s’est installé en système de gouvernance et de gestion des deniers publics.
Réformer la gouvernance est nécessaire. Mais sans une révolution silencieuse des pratiques, de l’éthique et de l’évaluation, aucune formule – élective ou nominative – ne sauvera l’université tunisienne de ses collèges invisibles et de ses alliances nocives.
Le défi n’est pas seulement juridique ; il est moral, scientifique et national.
E4T
A s’attendait à mieux de nos universités et universitaires. Cette tête pensante a échoué l’épreuve de la transition démocratique dans le domaine de la gouvernance performance des milieux universitaire. Preuve et épreuve …
La Tunisie s’apprête à franchir un pas symbolique dans la gouvernance universitaire. Le projet de loi n°8 de 2026, déposé à l’Assemblée des représentants du peuple, vise à modifier l’article 15 de la loi n°19 de 2008 et à mettre fin à l’élection des présidents d’université, principe instauré par le décret-loi n°31 de 2011 après la révolution.
Demain, si le texte est adopté, le ministre de l’Enseignement supérieur pourra nommer les recteurs parmi les professeurs habilités, pour un mandat renouvelable. La rupture est nette : on passerait d’une légitimité élective à une légitimité administrative.
L’autonomie universitaire pervertie
Le débat est vif. La Fédération générale de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, affiliée à l’UGTT, dénonce un « recul dangereux » et un retour à la logique des nominations verticales.Des universitaires comme Abdelkader Hamdouni, de l’Université de Monastir, rappellent que l’élection confère une légitimité scientifique et crée un équilibre entre autorité ministérielle et autonomie académique. Mounir Saidani, sociologue à Tunis El Manar, souligne qu’un président élu présente un programme débattu par ses pairs et peut être sanctionné par les urnes s’il échoue.
Ces arguments méritent d’être entendus. Mais ils ne doivent pas masquer une autre réalité, plus dérangeante : l’incapacité chronique d’une partie de la communauté universitaire à faire de l’autonomie un levier de développement du savoir, des compétences et du rayonnement international.
On a mal compris la gestion autonome
L’élection, en soi, n’a jamais garanti la qualité. Elle a parfois consacré des équilibres de clans, des compromis régionaux, des alliances idéologiques et des logiques de « copains d’abord ».Dans de nombreuses facultés, les « collèges invisibles » gouvernent. Ils orientent les promotions, verrouillent les jurys d’habilitation, distribuent les responsabilités administratives et contrôlent l’accès aux conférences et aux subventions publiques.
Un professeur de sciences exactes confiait récemment, sous couvert d’anonymat : « Ici, ce n’est pas le meilleur article qui compte, c’est la meilleure alliance. » Un autre, en sciences humaines, ajoutait : « On a remplacé l’autoritarisme d’État par l’autoritarisme des réseaux. »
Le mal est profond lorsqu’il touche à la publication scientifique. Dans certaines disciplines, les mêmes noms se retrouvent en première position sur des articles co-signés en cascade, cités par les mêmes cercles, invités dans les mêmes colloques organisés par les mêmes équipes.
Des castes se forment autour de laboratoires puissants, dotés de budgets et de relais institutionnels. Les conflits d’intérêts sont rarement déclarés, les évaluations parfois biaisées, les pressions bien réelles. Un jeune maître-assistant résumait la situation avec amertume : « On m’a conseillé de choisir mon camp avant de choisir mon sujet de recherche. »
La sélection adverse: quand les moins productifs mènent la barque
Comment évalue-t-on un professeur universitaire ? Ce n’est ni le titre, ni l’ancienneté, ni la proximité avec un syndicat ou un parti qui devraient primer. Les critères sont connus et universels : la qualité et l’impact des publications dans des revues à comité de lecture, les indices de citation (h-index, facteur d’impact), la participation à des réseaux internationaux, la capacité à obtenir des financements compétitifs, la direction de thèses aboutissant à des carrières solides, le respect de l’éthique et des étudiants.Un professeur se mesure à son apport au savoir et à la société, pas à sa capacité à manœuvrer dans les couloirs.
Or, le bilan global interroge. Les classements internationaux majeurs – qu’il s’agisse du Shanghai Ranking ou d’autres palmarès mondiaux – ne font guère apparaître d’universités tunisiennes parmi les institutions visibles.
Les publications sont quantitativement présentes, mais qualitativement inégales. Les diplômés peinent à s’insérer sur un marché du travail exigeant, tandis que les dépenses publiques d’enseignement supérieur continuent d’augmenter. L’équation est brutale : plus de moyens, mais peu de rayonnement.
L’UGTT a noyauté la décadence
L’UGTT, acteur central du paysage universitaire, porte aussi sa part de responsabilité. Défendre les droits sociaux est légitime. Mais la défense des statuts ne s’est pas toujours accompagnée d’une exigence équivalente en matière de productivité scientifique, d’évaluation rigoureuse et d’ouverture internationale.Un ancien doyen le disait crûment : « On a appris à bloquer des réformes, pas à bâtir des stratégies. » La syndicalisation de la gouvernance a parfois renforcé les rapports de force internes au détriment de la performance académique.
Faut-il pour autant applaudir la recentralisation ? Rien n’est moins sûr. La nomination ministérielle pourrait corriger certains abus locaux, mais elle risque d’introduire d’autres dépendances, d’autres loyautés, d’autres formes d’alignement. Un président nommé regardera-t-il d’abord vers sa communauté académique ou vers l’autorité qui l’a désigné ? La question de la légitimité demeure.
Le véritable enjeu n’est peut-être pas l’élection contre la nomination, mais la culture d’évaluation et de responsabilité, contre les diktats des clans et collèges invisibles. On peut élire des médiocres comme on peut nommer des excellents.
Ce qui manque, c’est un système transparent d’indicateurs publics : tableaux de bord par université, taux d’insertion des diplômés, volume de publications indexées, nombre de partenariats internationaux, respect des délais de thèse, évaluation anonyme des enseignements par les étudiants. La lumière est le meilleur antidote aux clans.
La Tunisie ne peut se permettre d’être trahie par ses propres élites académiques. L’université n’est pas un champ de bataille idéologique ni un terrain de distribution de privilèges.
Elle est un espace de production de savoir, de formation de compétences utiles et employables, et de rayonnement culturel et scientifique. Si les universitaires veulent préserver leur autonomie, ils doivent prouver qu’ils savent l’exercer avec rigueur, équité et ambition.
Au fond, la loi sur la nomination des recteurs agit comme un révélateur. Elle met à nu les fragilités d’un système qui n’a pas su transformer la liberté retrouvée en excellence partagée. Un système de sélection adverse s’est installé, le principe des « amis d’abord » s’est installé en système de gouvernance et de gestion des deniers publics.
Réformer la gouvernance est nécessaire. Mais sans une révolution silencieuse des pratiques, de l’éthique et de l’évaluation, aucune formule – élective ou nominative – ne sauvera l’université tunisienne de ses collèges invisibles et de ses alliances nocives.
Le défi n’est pas seulement juridique ; il est moral, scientifique et national.


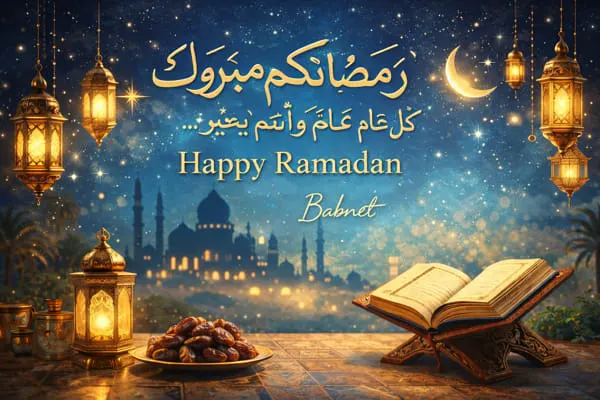























Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324090