La politique arabe de la France : les vestiges d’un passé révolu
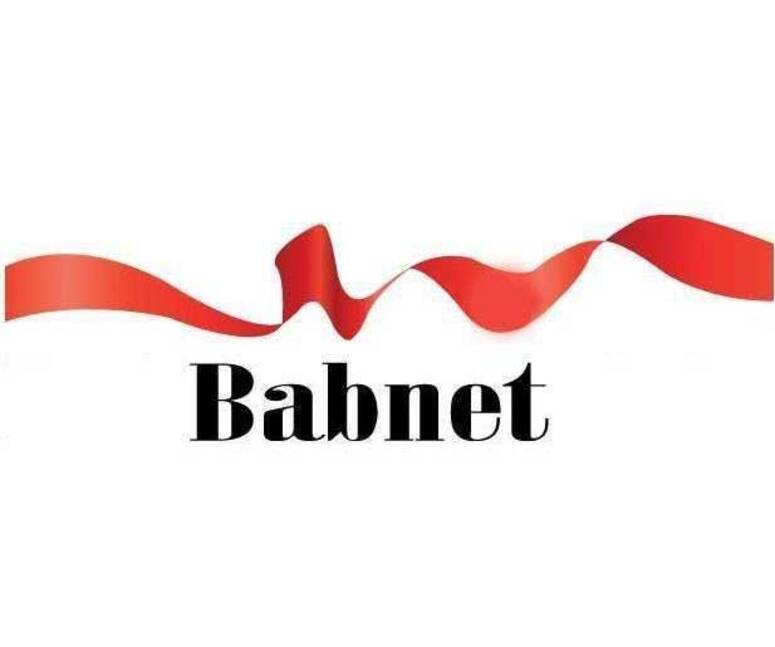
Par Fériel Berraies Guigny. Paris
La politique arabe de la France, ses permanences et ses ruptures, ses innovations et ses régressions, a depuis toujours eu un impact considérable sur notre région. Napoléon disait à juste titre, que « la géographie dicte la politique d’un pays ». La politique arabe du second Empire au Machrek était avant tout le fruit des idées personnelles de Napoléon III, de l'histoire générale de la France dans cette région et, plus particulièrement, des orientations de politique étrangère de la France entre 1850 et 1870. L'action diplomatique française se fondait sur deux axes principaux. Le premier concernait le protectorat chrétien de la France et la reprise en main de la prépondérance de l'Empire sur les Lieux Saints et le second s'appuyait sur le canal de Suez, développant l'arme diplomatique de la France dans la mer rouge et le Golfe arabo-persique. La France tout au long de son histoire a bâti les deux axes de sa politique extérieure sur l’Europe et le monde arabe.
Jacques Chirac, dés son élection, marquera en 1996 avec sa tournée au Proche-Orient, le retour à une certaine politique arabe, avec en point d’orgue le NON à l’intervention américaine en Irak. Mais ce retour de la diplomatie française dans la région n’a pas entraîné par contre de facto une politique arabe de l’Europe. Au contraire, durant la crise irakienne, la quasi-totalité des chefs d’Etat et de gouvernements européens - à commencer par ceux du bassin méditerranéen -appuiront la politique américaine dans le Golfe, parfois même militairement !
La politique arabe de la France, ses permanences et ses ruptures, ses innovations et ses régressions, a depuis toujours eu un impact considérable sur notre région. Napoléon disait à juste titre, que « la géographie dicte la politique d’un pays ». La politique arabe du second Empire au Machrek était avant tout le fruit des idées personnelles de Napoléon III, de l'histoire générale de la France dans cette région et, plus particulièrement, des orientations de politique étrangère de la France entre 1850 et 1870. L'action diplomatique française se fondait sur deux axes principaux. Le premier concernait le protectorat chrétien de la France et la reprise en main de la prépondérance de l'Empire sur les Lieux Saints et le second s'appuyait sur le canal de Suez, développant l'arme diplomatique de la France dans la mer rouge et le Golfe arabo-persique. La France tout au long de son histoire a bâti les deux axes de sa politique extérieure sur l’Europe et le monde arabe.
Jacques Chirac, dés son élection, marquera en 1996 avec sa tournée au Proche-Orient, le retour à une certaine politique arabe, avec en point d’orgue le NON à l’intervention américaine en Irak. Mais ce retour de la diplomatie française dans la région n’a pas entraîné par contre de facto une politique arabe de l’Europe. Au contraire, durant la crise irakienne, la quasi-totalité des chefs d’Etat et de gouvernements européens - à commencer par ceux du bassin méditerranéen -appuiront la politique américaine dans le Golfe, parfois même militairement !
La politique arabe de la France s’est depuis lors faite, « contre l’Europe ». Aujourd’hui, à la veille des élections présidentielles, la politique étrangère française est en pleine mutation. Les grandes orientations stratégiques de la Vème République qu'on avait baptisées gaullo-mitterrandistes sont maintenant remises en question. Et le clivage qui opposait la droite à la gauche, n’a plus sa raison d’être, s’opérant à l'intérieur de chaque camp.
Il y aurait deux tendances, ceux qui prônent un rapprochement avec les Etats-Unis au nom de l'alliance des démocraties et de la solidarité occidentale. Une ligne qu’incarne aussi bien Nicolas Sarkozy que Dominique Strauss-Kahn en rupture avec la tradition française. Ils prônent à cet effet, la fin de la politique arabe de la France . Une politique perçue comme étant avant tout une compromission avec des « régimes peu recommandables ». Cette mouvance est par contre, favorable à un rapprochement accentué avec Israël, présenté comme la « seule démocratie du Proche-Orient ».
La question palestinienne, dés lors, risquant de se faire reléguer à l'arrière-plan.
En face, aussi bien à droite qu'à gauche, persisterait cependant, une opposition farouche à cette volonté de rupture. Incarnée par la mouvance de Ségolène Royal et Laurent Fabius. Tous deux sont très critiques sur la façon dont les Etats-Unis mènent la guerre contre le terrorisme. Pour eux, George W. Bush a contribué à aggraver le problème beaucoup plus qu'à le résoudre. Largement opposés à la politique étrangère de Bush, sans être « anti américains », comme l'est, selon eux, la majorité des Français.
Au sein de l'UMP, le positionnement de Sarko l'Américain fait par contre grincer les dents de ceux qui veulent réaffirmer les principes gaullistes, comme Dominique de Villepin et Michèle Alliot-Marie. La Ministre de la Défense a d'ailleurs tenu à réaffirmer fortement les principes de l'autonomie de la France lors de son séjour aux Etats-Unis. Autonomie, bien mise à mal durant la visite de Sarkozy à Washington, puisque voulant rentrer dans les bonnes grâces américaines, il qui n’a pas hésité à critiquer ouvertement la politique étrangère de son gouvernement !
Cependant, mettre entre parenthèses la politique arabe de la France, comporte certains risques. Risques que néo-gaullistes et néo-mitterrandistes partagent. Ils craignent en effet, que la dénonciation de certains aspects de la politique arabe de la France ne soit un prétexte pour cesser d'avoir une politique active dans la région et y perdre des positions. Les premiers privilégient l'approche de gouvernement à gouvernement, et les seconds préfèrent renforcer les contacts avec les sociétés civiles. Mais tous pensent que la France doit redéfinir et réaffirmer une politique spécifique dans la région, pas l'abandonner complément. Le livre de Pascal Boniface qui sortira prochainement en janvier 2007, nous donnera un aperçu sur la place que la France « devrait jouer dans le monde ».
Entretien avec Gérald ARBOIT.
Fériel Berraies Guigny a rencontré, à Paris, Gérald Arbois, historien pour discuter de l’état de la politique arabe française, de ses ambitions et de ses limites actuelles.

Parlez nous de votre livre, et à quand remontent les relations franco arabes ? Que reste-t-il aujourd’hui de la politique arabe de la France, telle que voulue par le Général de Gaulle?
Vaste question que de vouloir trouver une origine à la politique arabe de la France. Les sources sont multiples et donc étalées sur une longue période. Qui plus est, il faut s’entendre sur les significations terminologiques. Peut-on faire remonter les relations franco-arabes à Charlemagne et Harûn al-Rashid ? Doit-on attendre Saint-Louis, comme le clament les Maronites ? Ou bien Louis XIV et son alliance avec les Turcs, ce qui nous éloigne des Arabes pour nous ouvrir aux puissances musulmanes ? L’expédition d’Egypte de Bonaparte concerne-t-elle le monde arabo-musulman ou les relations franco-britanniques ? Même chose pour la gestion des suites de la débâcle égyptienne en Syrie, en 1840 ? Les points d’entrées sont nombreux.
Mais je pense que la véritable définition, non d’une politique raisonnée — pour cela il faudra attendre d’être débarrassé de la question algérienne, après 1962 —, mais d’un faisceau de pensées à destination des populations arabes, quelles que soient leurs sensibilités religieuses, et non exclusivement chrétiennes, date de la période du Second Empire. Le Proche-Orient, déjà compliqué, n’est pas perçu comme un
 objectif colonial par Napoléon III. C’est l’idée nationale, reprenant cette exaltation de l’arabité de Bonaparte en Egypte, qui l’amène à s’intéresser au Proche-Orient. Mais les questions d’intérêts particuliers, qu’il s’agisse de Lesseps et de son canal, des velléités du Saint-Siège de reprendre la main en Syrie ou des nécessités de la politique européenne, auxquelles s’ajoute la contradiction fondamentale d’un discours colonial au Maghreb alors qu’on prône l’inverse au Machrek, donnent un côté brouillon à la position française. C’était le sens même de mon propos dans Aux sources de la politique arabe de la France. Et non une quelconque volonté de réhabiliter Napoléon III…
objectif colonial par Napoléon III. C’est l’idée nationale, reprenant cette exaltation de l’arabité de Bonaparte en Egypte, qui l’amène à s’intéresser au Proche-Orient. Mais les questions d’intérêts particuliers, qu’il s’agisse de Lesseps et de son canal, des velléités du Saint-Siège de reprendre la main en Syrie ou des nécessités de la politique européenne, auxquelles s’ajoute la contradiction fondamentale d’un discours colonial au Maghreb alors qu’on prône l’inverse au Machrek, donnent un côté brouillon à la position française. C’était le sens même de mon propos dans Aux sources de la politique arabe de la France. Et non une quelconque volonté de réhabiliter Napoléon III… D’ailleurs, si l’on reprend la politique gaullienne à destination du Proche-Orient, ces fameuses « idées simples », reprennent cette éthique nationale et de grandeur. Mais les pivots de cette politique élaborées après 1962, l’Algérie, comme ouverture vers le Tiers Monde et le monde arabe, et Israël, comme rejet de toute forme d’impérialisme, s’ils sont bien adaptés aux intérêts de la France du moment, sont loin de faire l’unanimité parmi la classe politique française. Et ne parlons pas des partenaires européens de la France. Le malentendu avec
 Washington est très gaullien, mais il ne peut durer longtemps dans la période de guerre froide. D’autant que s’amoncèlent les nuages (chocs pétroliers, crise morale, terrorisme islamique, immigration de moins en moins contrôlée…).
Washington est très gaullien, mais il ne peut durer longtemps dans la période de guerre froide. D’autant que s’amoncèlent les nuages (chocs pétroliers, crise morale, terrorisme islamique, immigration de moins en moins contrôlée…). Cette politique ne trouve-t-elle pas des limites aujourd’hui dans la coopération politique européenne ? Que pensez également de l’impact du « calendrier américain » dans cette politique ?
Oui et non. Il faut bien comprendre que la construction européenne est avant tout une manifestation d’adhésion à l’Atlantisme. La Communauté économique européenne naît en pleine Guerre froide. Il faut reconstruire l’Europe. Ce qui explique, une fois l’Europe reconstruite, mais le Mur de Berlin disparu, son impossibilité à s’emparer du politique. Et ses gesticulations mondialistes, comme son ouverture, rapide et désordonnée, aux pays de l’ancien bloc soviétique, ne font que cacher la crise. Cela dit, l’Europe a tourné le dos, sous le poids de réajustements des années 1980, à son sud, quel qu’il soit.
La France a néanmoins tenu à conserver ses apanages de puissance, comme en témoigne sa présence au sein de la FINUL depuis ses débuts, ou en Afrique… Mais elle a cessé d’être, dès les années 1970, l’amie de tous, et en premier de l’arabité méditerranéenne. Le ressentiment qui se développe ensuite envers les communautés immigrées montre combien la fracture algérienne ne s’est pas refermée. Il montre également combien la flambée islamiste, qui se développe depuis l’Iran au Liban, puis prend racine en Algérie et enfin inaugure le « nouvel ordre international », en confondant socialisme arabe ou bosniaque et islamisme, brouille les cartes d’une France qui ne maîtrise plus les enjeux. Et ce n’est pas le « calendrier américain » post-11-Septembre qui en est responsable.
De Gaulle avait une personnalité qui lui
 permettait de dialoguer avec Nasser. La perception arabe peut facilement les assimiler. Mais la réalité géopolitique de la France, une réalité qui s’impose dès la fin des années 1960 et la disparition de de Gaulle, impose des choix qui ne sont pas en relation avec le Proche-Orient. La Guerre froide ne tolère pas de troisième voie et impose de choisir Washington ou Moscou. Pour la France, il n’y a pas d’alternative possible. Et depuis 1990, la marge de manœuvre est plus que limitée. Aujourd’hui, le beau discours du 5 février 2003 de Dominique de Villepin n’a guère de poids face au PowerPoint de Colin Powell. Restent le « vieux pays » et la « vieille Europe » à la remorque des Etats-Unis. Les perspectives intégrationnistes de l’Union européenne ne laissent que peu de place au monde arabo-musulman. D’autant que le 11 Septembre et l’invasion de l’Irak ont durablement changé les perspectives. Le rêve du Roi Hasan II de voir le Maroc, fer de lance de l’Union du Maghreb Arabe, intégrer l’Union a fait long feu…
permettait de dialoguer avec Nasser. La perception arabe peut facilement les assimiler. Mais la réalité géopolitique de la France, une réalité qui s’impose dès la fin des années 1960 et la disparition de de Gaulle, impose des choix qui ne sont pas en relation avec le Proche-Orient. La Guerre froide ne tolère pas de troisième voie et impose de choisir Washington ou Moscou. Pour la France, il n’y a pas d’alternative possible. Et depuis 1990, la marge de manœuvre est plus que limitée. Aujourd’hui, le beau discours du 5 février 2003 de Dominique de Villepin n’a guère de poids face au PowerPoint de Colin Powell. Restent le « vieux pays » et la « vieille Europe » à la remorque des Etats-Unis. Les perspectives intégrationnistes de l’Union européenne ne laissent que peu de place au monde arabo-musulman. D’autant que le 11 Septembre et l’invasion de l’Irak ont durablement changé les perspectives. Le rêve du Roi Hasan II de voir le Maroc, fer de lance de l’Union du Maghreb Arabe, intégrer l’Union a fait long feu… Comment expliquez vous qu’après avoir appelé à l’organisation d’élections libres et avoir directement veillé au bon déroulement du processus électoral dans les territoires palestiniens, l’UE ait par la suite imposé en avril 2006, des sanctions financières contre ce même gouvernement issu d’élections libres ?
L’effet 11 Septembre… L’Europe peine à définir un discours étranger déconnecté de la position américaine. Les raisons sont diverses. D’abord la nécessité de l’unanimité sur ces questions ; et il n’y a pas que Londres à s’opposer à Paris… Ensuite l’absence d’intérêts dans cette région bien particulière. Certes, l’Union européenne se prononce, mais sur des questions faisant l’actualité, et presque toujours selon des critères humanitaires ou de droits de l’Homme. Il n’est qu’à voir son temps de réaction cet été, lors de la crise libanaise. Le Proche-Orient, notamment dans son acception israélo-arabe, est politiquement miné. Et la main est clairement américaine… Et puis ce continent largement déchristianisé est rongé par la peur de ce que l’on nomme l’« islamisme radical », qui commence avec les Frères musulmans et le Wahhabisme avant d’être salafiste. Depuis le temps que les médias présentent le Hamas, mais aussi le Hizb‘allah, comme des mouvements terroristes — ce qu’ils sont —, l’Occident en a oublié leur dimension sociale. L’amalgame créé par le 11 Septembre n’arrange rien.
De nos jours, la Méditerranée et le Moyen-Orient sont essentiellement perçus par les Européens comme une « zone dangereuse » pour l’Occident : menace pour sa stabilité et sa sécurité, terrorisme, propagation de la religion musulmane dans le fief de la chrétienté, pourquoi ? Comment percevez vous la politique à l’égard du monde arabe, s’agissant des questions relatives à l’intégration, au terrorisme, à l’immigration clandestine ?
Le phénomène n’est pas nouveau. L’absence de politique méditerranéenne, la crise européenne depuis l’échec constitutionnel et son choix — celui de la simplicité et qui représente une tentation récurrente de l’Union, alternative à l’intégration communautaire — de l’élargissement à la Roumanie et à la Bulgarie, mais pas dans l’immédiat à la Bosnie, à la Serbie et à la Croatie, et encore plus tard, sinon jamais, à la Turquie, l’afflux d’immigrants clandestins venant d’Afrique… sont certes des phénomènes d’actualité. Mais ils plongent leurs racines dans les années 1980. A partir de 1983, c’est-à-dire de la première flambée de violence dans les banlieues, les médias français commencent à présenter les communautés immigrées d’origine musulmane comme des étrangers appartenant à une « communauté arabe » construite. Elle est construite à partir des données de l’actualité internationale : on est aux lendemains de la révolution iranienne, des attentats antisémites de Paris, des attentats nationalistes palestiniens et arméniens en Europe… Cette « communauté arabe » que véhiculent les médias depuis cette époque, mais qu’ils se gardent bien de définir, participe de sa déterritorialisation et renforce cette idée de dangerosité de la rive sud du Mare Nostrum.
Tout finit par se confondre dans une même perspective sécuritaire, les immigrés clandestins, les filles voilées, les délinquants… Renvoyer les Européens — c’est-à-dire ceux qui sont nés, qui ont été éduqués, qui vivent dans un pays européen — de religion musulmane qui, pour leur plus grande majorité, ont la nationalité des pays où ils résident, à leur statut d’étrangers permet de construire un ennemi civilisationnel, à la fois lointain pour que l’on n’éprouve pas de sentiment belliciste, mais suffisamment proche pour nourrir les stéréotypes belliqueux. Le 11 Septembre n’a fait que pérenniser le regard occidental envers tout ce qui trait, de prêt ou de loin, à l’Islam comme un soutien au terrorisme. Dites des propos apaisés sur l’Islam et la rumeur médiatique a tôt de vous considérer comme un converti, comme un de ces « barbus » qui hantent les sous-sols des immeubles de banlieue… Les malentendus civilisationnels, du genre de la crise des caricatures, ne sont pas pour arranger les choses. Les autorités politiques semblent percevoir le risque. Le processus de Barcelone, initié dans la foulée de la première Guerre du Golfe (1991), en est un exemple. Mais je ne suis pas certain que confier à la société civile le soin d’éviter le clash civilisationnel soit une bonne chose, comme c’est le cas avec l’atelier culturel Europe-Méditerranée-Golfe, dont la première séance s’est tenue à Paris en septembre dernier, avant deux autres rencontres à Séville et à Alexandrie. Surtout sans réelle présence des organisations internationales les plus concernées, comme l’Unesco ou le Conseil de l’Europe. Je suis plus confiant dans la démarche de cette dernière institution, qui a entrepris en octobre la réflexion terminale autour d’un projet d’enseignement de l’Histoire concernant « L’image de l’Autre ».
Durant les deux mandats présidentiels du Président Chirac, on dit que la politique arabe de la France était plus une politique de « complaisance » sans une connaissance véritable des besoins et des réalités du terrain, qu’en pensez vous ? que pensez vous du dernier livre d’Eric Aeschimann et Christophe Boltanski, Chirac d’Arabie, cela illustre t-il vraiment les limites et la réalité de cette politique ? S’agissant du partenariat euro-méditerranéen, quelles sont les conditions pour bâtir réellement une zone de paix et de prospérité dans la région ?
Le problème est que les deux mandats se sont limités à un seul. Et s’il faut en retenir quelque chose à destination du monde arabe, c’est l’opposition française à la deuxième Guerre du Golfe (2003). Si Lionel Jospin avait été son Premier ministre à cette époque, il y a fort à parier que la France serait aujourd’hui en première ligne à Bagdad… Que le reste n’ait été que « complaisance », cela va s’en dire, dans la mesure où la France n’a plus vraiment de politique à destination du Proche-Orient depuis le départ de de Gaulle. Et encore celle-ci n’était que conjoncturelle : il fallait effacer le souvenir de la guerre d’Algérie et de l’expédition de Suez, tout en assurant l’indépendance diplomatico-militaire de la France et son rayonnement spirituel. Cette réalité est largement oubliée dans la fameuse « politique arabe de la France ». L’arrivée de Jacques Chirac à la présidence avait suscité l’espoir chez les dirigeants arabes, dont la plupart avait connu de Gaulle. Mais cette attente ne pouvait être satisfaite. La France n’avait pas de solution au conflit israélo-arabe. Son impulsion autour du nucléaire iranien n’a rien donné. Pas plus que son opposition à l’intervention américaine… Et tous les leaders régionaux qu’il connaissait personnellement, présents depuis aussi longtemps que lui en politique, sont morts, remplacés par des inconnus, le plus souvent portés sur la realpolitik, se tournant vers les Etats-Unis. Quant à ceux qui restent, ils sont devenus infréquentables ou lui tournent ostensiblement le dos. « Tout Chirac est là : une grande clairvoyance sur les transformations profondes en cours, mais aussi une incapacité à en déduire autre chose qu’un immobilisme théorisé », en en déduit Eric Aeschimann et Christophe Boltanski…
La France en tant qu’ancienne puissance coloniale, dispose d’un capital d’influence important, pensez vous que cela lui suffirait à corriger « certaines des failles » de sa politique étrangère ? La France peut elle avoir une politique « euro-arabe » et quelles sont les conditions ? aux vues des prochaines élections présidentielles, qu’est ce qui se profile pour la politique étrangère française ?
Son capital d’influence ne repose justement pas sur son passé colonial. L’arabité exaltée par la France en 1798, entre 1830 et 1860, a été tue sous les Troisième et Quatrième républiques au nom de l’expansion coloniale. Il importa à De Gaulle de rétablir la continuité historique interrompue par l’aventure coloniale. L’influence française est donc d’abord celle de la décolonisation, mais elle repose aussi sur un capital de culture et de pratique de la langue française. Sa politique arabe, si spécifique qu’elle tient lieu de mythe institutionnel, est donc particulièrement partie d’une politique étrangère généreuse, revendiquant l’héritage des Lumières. On la retrouve dans cet autre coquille vide qu’est la Francophonie, cette vaste communauté qui n’a jamais pu s’émanciper de cette velléités de poursuivre l’histoire coloniale bien après le colonialisme…
La France pourrait retrouver un rôle-moteur si elle parvenait à relancer la question de la frontière Sud de l’Europe, dans une perspective qui ne serait pas essentiellement arabe. Mais, là encore, personne n’attend la France. L’Italie, l’Espagne, la Grèce ont pris de l’avance depuis vingt ans. Et encore une fois les Etats-Unis sont en embuscade, notamment dans le pétrole algérien. Et c’est sans compter la Chine, qui a passé les deux dernières années à scanner l’Afrique, envoyant des missions d’étude dans tous les pays depuis la Méditerranée au Pacifique, et de l’Atlantique à l’Océan Indien. Compte-tenu de l’expérience internationale, notamment de leur atlantisme clairement affiché, je ne vois pas la Carpe ou le Lapin provoquer une surprise, à tout le moins dans une « réorientation » de la politique arabe de la France. Une réorientation vers quoi ?
Vous avez écrit sur l’Irak, que pensez vous du procès et de l’exécution précipitée de Saddam Hussein ? Quel est l’avenir de la démocratie en Irak ? Sera-t-elle le fruit de l’Occident ou au contraire, contribuera-elle à l’en éloigner ?
… au terme d’un procès rapide. Sans revenir sur les bienfaits ou non de la peine de mort, je n’y vois aucune démonstration démocratique. Le système politique en vigueur en Irak est loin d’être démocratique. Organiser des élections, avoir un parlement ne sont pas des gages de démocratie. Saddam Hussein avait tout cela, pourtant il ne viendrait à l’idée de personne de qualifier son régime de démocratique. Et pourtant, il y avait plus de démocratie dans son régime à parti unique que dans la théocratie chi‘ite en train de se constituer sous nos yeux. Le parti ba‘ath n’a jamais été islamiste. C’est un parti socialiste arabe, fondé sur la laïcité, qui n’empêchait pas une conception musulmane de faire de la politique. Les femmes et les minorités religieuses n’étaient pas considérées comme des citoyens de seconde zone. L’accès à la culture était libre. Les populations urbaines et rurales n’étaient pas soumises à des états de droits différents. Certes, les droits civiques étaient restreints. Mais combien d’Etats inscrits aux Nations unies, parfois voisins de l’Irak, sont dans le même cas. Portant on ne déclenche pas d’opérations militaires contre eux, sous des prétextes fallacieux…
Les guerres ne fondent pas les démocraties. D’ailleurs, qu’est-ce que la démocratie ? Est-ce que le principe du clientélisme et du patronage, que l’on retrouve en terre d’Islam sous la notion de zaîm, ne participe pas à l’idéal démocratique ? Il fonde pourtant la vie politique de la république romaine, depuis ses plus profondes origines jusqu’à l’Empire, permettant même la dictature de César… Tout l’héritage démocratique de l’Europe occidentale se retrouve dans ce principe. L’Europe a mis vingt siècles à le mettre en pratique. Pourquoi vouloir imposer à des sociétés qui n’ont pas le même parcours, ni le même idéal démocratique, qu’elles fassent le même chemin en moins d’une génération ? On n’a vu le destin de la monarchie parlementaire égyptienne et du confessionnalisme libanais ! Il n’y a au Moyen-Orient qu’une seule et véritable démocratie, Israël, mais il est vrai que la majorité de sa population est d’origine européenne et il n’est qu’à voir l’influence des minorités d’ex-Union soviétique sur son fonctionnement récent… Montesquieu ne disait-il pas que la démocratie mûrissait sous le soleil, c’est-à-dire s’appliquait différemment selon les latitudes et les civilisations ? Pourquoi vouloir appliquer des bouleversements institutionnels qui s’opposent au fonctionnement social existant ? C’est plus du néo-colonialisme que des pratiques démocratiques…
Le monde arabo-musulman est de plus en plus meurtri, ne pensez vous pas que le musulman d’aujourd’hui est le juif du XXIe siècle ?
Vous faîtes allusion à la théorie de Vincent Geisser, dans la Nouvelle Islamophobie ? L’hypothèse est séduisante, mais elle ne fonctionne , si l’on suit le raisonnement de Geisser, que dans les communautés arabo-musulmanes d’Occident. Elles affichent un statut de dhimmi, c’est-à-dire qu’elles se retranchent sur leur dénominateur commun, la famille et une conception extériorisée de l’islam — ce qui est le trait de toute communauté émigrée— qui les rend étrangères aussi bien en Europe qu’au Maghreb et au Machrek. On peut voir également une analogie avec la victimisation qu’affichent certains Arabes, humiliés par la prétendue attitude occidentale envers les Palestiniens, les Bosniaques, les Tchétchènes et les Irakiens depuis une dizaine d’années. Mais, plutôt qu’une réalité tangible, il s’agit plus d’un témoignage envers de sociétés bloquées, où les maux dont souffrent les pays voisins du fait d’un ennemi commun, sinon identifiables, faute de moyens démocratiques d’expression…
Biographie
Gérald Arboit est docteur en Histoire contemporaine et ancien auditeur de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (Nancy, 2000). Au sein du Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R), il suit particulièrement les questions relatives à la théorie et à l'histoire du renseignement et collabore à la revue Renseignement et opérations spéciales. Il a co organisé plusieurs colloques, dont celui du CERIME en 2003, sur « La médiatisation de l’Histoire. De « l’utilisation du passé dans la construction de l’actualité », en 2004, « Les médias de masse et les causes de conflits majeurs. Et l’information dans le cas de « la guerre en l’Irak ». Collaborateur régulier de l’Annuaire français de relations internationales, Gérald Arboit est l’auteur de quatre ouvrages et de nombreux articles historiques et géopolitiques sur le monde arabe, l’histoire du renseignement et la diplomatie pontificale.
Ouvrages
- Fragments de la vie de Charles Schulmeister de Meinau. Un mémoire inédit de l'espion de l'Empereur Napoléon 1er , collection Culture du renseignement , L'Harmattan, Paris, 2003.
- Aux sources de la politique arabe de la France. Le Second Empire au Machrek , collection Comprendre le Moyen-Orient , L'Harmattan, Paris, 2000.
- Terres rouges. Le fer et le feu à Audun-le-Tiche , Jean-Baptiste Ferrai, publié par le comité d'établissement ARBED, Mines française - Mine des terres rouges, 1997.
- Le Saint-Siège et le nouvel ordre au Moyen-Orient. De la guerre du Golfe à la reconnaissance diplomatique d'Israël , collection Comprendre le Moyen-Orient, L'Harmattan, Paris, 1996.
- Renseignement et géopolitique, www.renseignement.blogspot.com.

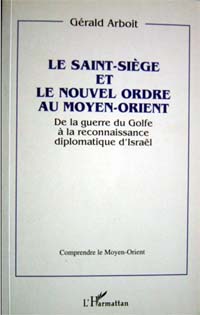
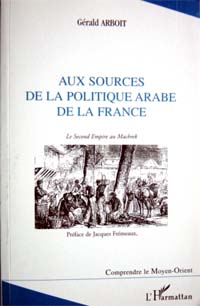
--------------

Fériel Berraies Guigny
www.journaliste.montaf.com
feriel.book.fr






















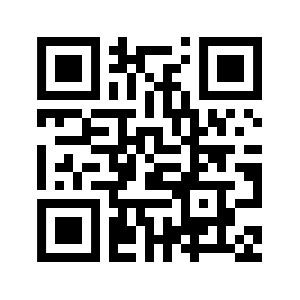
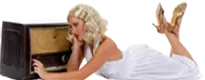
 Abdelhalim - أبو عيون جريئة
Abdelhalim - أبو عيون جريئة
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 9733